Le Manitoba est sans conteste le gros morceau de cette anthologie. L’introduction de J. R. Léveillé en expose les raisons : brossant un large portrait historique — notamment en décrivant le processus fondateur et émancipateur de séparation de la langue et de la foi —, il montre que la scène littéraire francophone dans la province est de nos jours très structurée, riche, organisée, puisqu’elle s’appuie sur une communauté francophone relativement nombreuse. Pas étonnant, dès lors, qu’on y trouve plus qu’ailleurs dans l’Ouest canadien des auteurs du cru, dont évidemment l’anthologiste lui-même… sans pour autant que le traditionnel ajout de voix venues de l’extérieur, dans ou hors des frontières du pays, soit négligé. Ce qui ressort de ce long chapitre, de ces vingt-six voix choisies avec soin, c’est évidemment la diversité des styles, mais aussi et surtout le dynamisme bouillonnant d’une vie littéraire bien réelle, loin du Québec qui concentre souvent tous les regards des francophones d’ailleurs.
Alexandre Amprimoz (1948-2012), ordre alphabétique oblige, donne à lire en premier sa poésie introspective et douloureuse : « ma douleur viole le voile de l’horizon / et les passants ne se doutent de rien // mon dieu / que le malheur est subtil ». Sans surprise, puisque la poésie est souvent langage de l’intime, l’introspection, les questions existentielles tiennent une place de choix dans les poèmes repris dans ce chapitre. Ainsi Bathélemy Bolivar (1975), Haïtien d’origine, écrit-il avec sa poétique de l’urgence de puissantes images où il « dérègle la maturité fluide du jour / notre corps fermente comme le premier vin / au creux des silhouettes d’accents futurs / que le temps cesse de rallonger ». Benoit Doyon-Gosselin (1976) renchérit : « dans la geôle perpétuelle / à l’heure du dernier repas / le sel et le poivre ne servent plus / ma langue », tandis que Daniel Lavoie (1949) — oui, il s’agit bien de celui qu’on connaît comme chanteur — tresse l’intime de particules élémentaires : « Ce soir-là, les quarks et antiquarks faisaient des sauts à couper le souffle. Et mon cœur beuglait, comme un taureau, blessé dans son meilleur, par un picador cruel. »
La poésie charnelle a aussi toute sa place, avec notamment Janick Belleau (1946), poétesse qui marche dans les traces de Sappho avec une touche d’inspiration japonaise : « Le ciel blanchit / j’imagine le temple / où sommeille ta chatte – / les battements de ton cœur / lentement ». Épure de la langue et thèmes féministes pour Lise Gaboury-Diallo (1957) également, même si on est malheureusement ici bien loin d’un amour à célébrer : « flots de sang et / jouissances effacées / la coupure / indélébile et calculée / rien qu’une toute / petite partie / enlevée de la somme / de sa pensée et de son corps / de femme ». Avec Jean Boisjoli (1949), retour à l’épure amoureuse (« le silence de mon corps / était vertu / sans dentelle / tu es descendue / dans notre anneau incertain / encerclée de langueur »), tandis que Bertrand Nayet (1962) propose entre autres de purs haïkus (« les lents flocons / estompent les branches grises / vol muet du corbeau »), tout comme Louise Dandeneau (1963) (« ombre chinoise / la mouche se débat / pour être libre »). La sensualité revient dans la poésie tout aussi élaguée de Laurent Poliquin (1975) : « quand je te fais de courtes nuits / dans ma tête / ta peau ne dit pas / elle entre seulement / goulue entre mes lèvres / pousse dans mon corps ». Quant à Paul Savoie (1946), il y ajoute une hypersensibilité émouvante : « j’ai gratté le givre / j’ai palpé le tissu des rideaux / dans l’espoir de vivre / dans les espaces ou dans les eaux ». Au Manitoba, beaucoup écrivent donc en aiguisant la plume, en coupant l’inutile, en distillant l’essentiel ; ce sera aussi le cas du poème de conclusion de cet article, écrit par J. R. Léveillé (1945). Encore quelques exemples ? François-Xavier Eygun (1956), quoique un peu plus lyrique : « Au sphinx des journées / succède le voile des nuits / il y reste l’ennui / et la triste renommée ». Ou Sante A. Viselli (1949), qui peut-être élague un peu moins : « Sans pays hors du temps / Tes seules lisières l’horizon / Ironique finitude de l’infini / Interprétant aveugle des énigmes / Magique beauté de l’Illusion // L’éternité ne serait que la traduction de ton regard éphémère ».


Le drapeau franco-manitobain
Louise Fiset (1955) oscille elle aussi entre deux pôles, le parler cash et le lyrisme : « Ô soul pleureur ! / Je ne crache pas des mines / La bouche en sang / Au soul plaisir de me perforer les poumons. / Je ne suis pas là à écrire mal pour conjurer le sort / Qui nous a placés sur terre / Mais pour conjuguer à l’indicatif présent / Le verbe haïr écrit en grosses lettres / Sur ma carte d’identité. » Une liberté de ton que pratique aussi Seream (1968), poète ludique à l’ironie parfois mordante (« Et mon Bouddha prenait du bide sur le rayon supérieur de l’étagère / et j’évitais les Maisons de la poésie à l’odeur accueillante de sanatorium / et les poètes s’y précipitaient éblouis par la gloire de la reconnaissance institutionnelle »), qu’on peut rapprocher du ludisme et de la joie de vivre de Charles Leblanc (1950) (« donnez-moi un langage / pour entendre le décapsulage / d’une bière au goût de montagne / les bribes de conversation d’un après-midi pluvieux / un crayon docile qui trace / une lettre d’amour bleutée »).
Tout n’est pas rose au Manitoba. Certains poètes emplissent leurs strophes de spleen, tel Rossel Vien (1929-1992) : « Les pieds ont pris la place de la tête, / La folie est courante / Comme dans une peinture de Chagall. / J’avoue mes défaites / L’une après l’autre. » Mais c’est la nostalgie qui souvent l’emporte. Ainsi Guy Gauthier (1939) évoque-t-il sa « Maman [qui] lave les fenêtres. Elle frotte la vitre avec du Windex. Le Windex est bleu. Je regarde maman à travers la bouteille. Elle est bleue. Elle frotte et le torchon crie sur la vitre. Il était blanc, il est noir. La vitre est nette. Elle brille. Maman est bleue. » La mémoire de Paul Brochu (1966) « s’éloigne / comme le passage des saisons / dans l’exil du temps », celle de Louis-Philippe Corbeil (1917-1993) construit un pont entre Winnipeg et Paris, pas forcément à l’avantage de la Ville Lumière : « L’autre hiver, j’ai vu la Seine / pleurer pendant que moi-même pleurais / l’hiver sur la Rouge. / Le bruissement des traîneaux glisse / sur les neiges, et le vent-nord / m’apporte les huiles du grand sud lumineux / pour éclairer mes mirages. »
Citons pour terminer ce roboratif panorama Léo A. Brodeur (1924-2001), à la poésie descriptive teinté de métaphysique (« poisson résurrectionnel / tu es la plus totale suspension dans l’absolu / mesurable / à l’éclat de l’unique rayon / de ton œil d’or / dans l’indigo ») et Christian Violy (1971), narratif, aux images fortes qui restent en tête (« elle s’étend sur la rosée / un souffle balaie les débris / son déhanchement / comme celui des feuilles d’un arbre fou de joie / elle le rejoint sur la lisière d’un étrange rêve »). Le tour d’horizon aura confirmé de belle manière ce « déploiement pluriel » que décrit l’anthologiste J. R. Léveillé dans son introduction.
Laissons-lui la parole pour conclure :
Abscisse
Voyage
dans la parole
Où trouver, moi,
dans la ligne, le lieu
et où placer, haut,
dans les pages, le toit
Poutres sûres
voltige d’araignée
Dessin de sa toison
foyer de son dessein
Fol âge
de la parole
Où toucher, moi,
dans les feuilles d’hiver
le soleil et atteindre
les grandes ombres
Plan tendu
de ciel à ciel
où vol
d’horizon à nuit
se constelle
Forage
de la parole
en elle
Où trouver, moi,
dans la ligne, le lieu
et où placer, haut,
dans les pages, le toit
Où étendre, où élever,
où tendre, moi
Dans œuvre de la première mort
J. R. Léveillé, Poésie franco-ouestienne 1974-2024, éditions du Blé, ISBN 9782925452034
L’anthologie est rédigée en nouvelle orthographe, respectée dans les citations.
Tous les articles sur cette anthologie en cliquant ici.
Florent Toniello, né en 1972 à Lyon, est le responsable de ce site, membre du comité de D’Ailleurs poésie. Il commence une première vie dans l’informatique au sein d’une société transnationale, à Bruxelles et ailleurs. En 2012, il s’installe dans la capitale grand-ducale ; sa deuxième vie l’y fait correcteur, journaliste culturel et poète. S’ensuivent neuf recueils de poésie publiés au Luxembourg, en Belgique et en France, une pièce de théâtre jouée au Théâtre ouvert Luxembourg, ainsi qu’un roman et un recueil de nouvelles de science-fiction. Pour l’instant, il n’est pas question d’une troisième vie. Son site personnel : accrocstich.es.

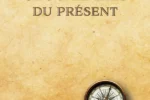




0 commentaires