Jonas Mekas (1922-2019) est un poète lituanien plus connu en France pour ses films et ses critiques de cinéma que pour sa poésie, laquelle est appréciée depuis longtemps dans son pays natal. Michaël Batalla cite cette réflexion de Mekas sur son travail de photographe et de cinéaste : « Ces images, j’en saisis certaines dans le monde “réel” et je les filme ; d’autres viennent de bien plus profond et je n’ai aucun contrôle sur elles ». C’est dire l’importance de la poésie pour Mekas. Le Centre international de poésie de Marseille a rassemblé en 2024 l’ensemble des poèmes écrits par lui en lituanien sous le titre : Debout parmi les choses. Poèmes 1948-2007 (éditions Nous). Le livre est le résultat d’un programme de traduction collective supervisé par le CIPM. La préface, très intéressante, est de Stéphane Bouquet (poète qui, hélas ! vient de mourir prématurément).
Mekas est né dans le village de Semeniškiai, où sa famille avait une ferme et où il a passé son enfance et son adolescence. Son premier livre de poèmes Idylles de Semeniškiai (1948) montre à quel point l’a marqué cette vie rurale, rythmée par les saisons et les travaux agricoles. La Lituanie est prise dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale avec l’occupation nazie, puis l’arrivée des Russes. Ayant publié un poème cinglant visant Staline, voilà Mekas obligé de s’exiler, menacé qu’il était de subir le sort d’un Ossip Mandelstam. En conpagnie de son frère, il traverse l’Europe dévastée avant de s’embarquer pour New York, où il arrive en 1949. Cette ville restera son port d’attache jusqu’à sa mort. Mais il continuera toute sa vie à écrire des poèmes en lituanien, « comme si, écrit Stéphane Bouquet, il poursuivait pour lui-même une sorte de murmure intime ancien ». Voici la première des Idylles de Semeniškiai :
Ancestral, le ruissellement de la pluie
Ancestral, le ruissellement de la pluie sur les branches,
le tonnerre des grands tétras dans l’aurore rouge de l’été,
ancestral, notre patois d’ici :
pour dire les champs blonds d’avoine et d’orge,
les bergers et leur feu solitaire dans le vent humide de l’automne,
la récolte des pommes de terre,
dire les chaleurs suffocantes de l’été,
l’éclat blanc de l’hiver, les traîneaux carillonnants sur des routes sans fin.
Et les chariots lourds de troncs coupés, la pierre des jachères,
les poêles en briques rouges et les champs calcaires ;
et, lors des veillées à la lueur des lampes, dans la grisaille des champs d’automne,
dire les chariots des marchés du lendemain,
les chemins défoncés et inondés d’octobre,
la récolte mouillée des pommes de terre.
Ancestrale, notre vie ici : de longues générations
ont foulé les champs et laissé des traces,
chaque arpent recèle toujours la voix et le souffle des ancêtres.
À ces mêmes puits froids
ils abreuvaient au retour leurs larges troupeaux,
et quand les sols de terre se creusaient,
que les murs des chaumières commençaient lentement de s’effriter,
dans ces mêmes trous ils récoltaient l’argile jaune,
le sable doré, dans ces mêmes champs.
Et quand nous serons partis à notre tour,
d’autres iront s’asseoir sur les pierres bleues à la lisière du champ,
ils faucheront les prairies foisonnantes et laboureront les pentes ;
et quand, au retour du labeur, ils se mettront à table,
chaque table parlera, chaque cruche d’argile,
chaque poutre du mur ;
ils se rappelleront les larges fossés jaunes de gravier et de sable
et les champs de seigle ondulant dans le vent,
les complaintes de nos femmes à la lisière des champs de lin,
et cette odeur — la première fois dans une nouvelle ferme ! —
le parfum de mousse fraîche.
Ô, ancestral le trèfle en fleur,
les chevaux qui s’ébrouent dans les nuits d’été,
et le frou-frou des rouleaux, des herses et des charrues,
le lourd grondement des meules des moulins,
le chatoiement blanc des foulards des femmes sarclant le potager ;
ancestral, le ruissellement de la pluie sur les branches,
le tonnerre des grands tétras dans l’aurore rouge de l’été,
ancestral, notre patois d’ici.
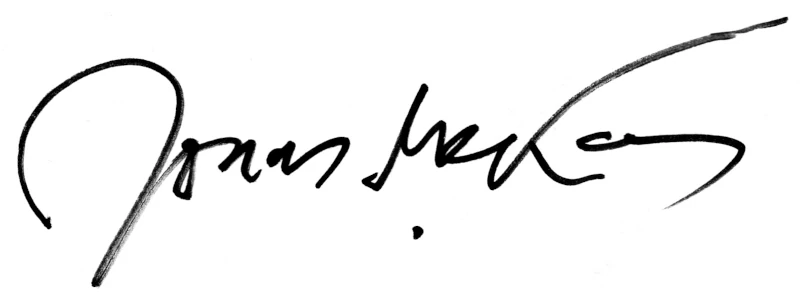
Image de la signature de Jonas Mekas : Arz, CC BY-SA 3.0
« Idylle », on le voit dans ce poème (et c’est le cas dans tous les autres du recueil) est à prendre au sens de scène champêtre paisible sans aucune allusion à une relation amoureuse. Voici ce que dit Bouquet : « Le premier poème qui s’ouvre et se ferme sur les mêmes vers est une autre façon de dire que ce monde est comme fermé sur lui-même. Quelque chose ici est clos et se tient lumineux dans le souvenir. Champs, puits ou portes qui grincent, troupeaux, moissonneurs, femmes en fichus, charrettes ou carrioles, gens à genoux dans la terre glaiseuse arrachant les pommes de terre, innombrables effets de la météo qui organisent bien sûr les travaux et les jours, dans ce poème qui pourrait être une version moderne des Géorgiques. » Ces poèmes sont-ils aussi « un cri de révolte » contre la soviétisation de la Lituanie par les Russes après la guerre ? C’est possible. Mais on va voir l’importance du travail de la mémoire dans le recueil suivant. Deux ans après son arrivée à New York, Mekas termine Réminiscences (1951). Voici des extraits du long et dernier poème de ce recueil, qui est composé de huit poèmes. Ce huitième est malheureusement trop long pour être cité en entier.
8
[…] Où est mon foyer, où mon pays, où ma patrie ?
Les hommes et les villes, les ponts des fleuves,
les plaines saumâtres du nord, les moulins à vent,
et les étendues des champs d’automne !
J’ai emporté chaque senteur rencontrée,
chaque chose, chaque son, et le toucher fragile
et fragrant des champs et des fleuves,
transportant tout, depuis l’enfance,
toujours affamé, toujours en mouvement,
je m’attachais à chaque nouvelle rencontre,
à chaque réverbère !
La nostalgie est évidente, mais quelque chose d’autre se manifeste : une quête de « nouvelles rencontres ». Le poète apostrophe New York (la ville et les environs de la ville), mais aussi une femme dont le nom apparaît plus tard :
[…] Bear Mountain, Hicksville, Lake Iroquois,
les petites maisons de Stony Brook,
(te souviens-tu, comme ce matin-là, nous regardions
en contrebas de la villa, sentant
combien chaque minute vécue
s’enracine en profondeur, ne se laisse plus arracher,
comme si c’était une part du vécu, de la sensation,
comme une part de soi-même,
du plus précieux :
le foyer) —
Foyer, foyer. Chaque endroit,
chaque horizon, rencontre, visage —
chaque pause, chaque regard :
les attaches. Le foyer.
Stéphane Bouquet écrit très justement : « On a presque le sentiment que le fait de se souvenir suffit à lui procurer de la joie et que la matière du souvenir compte moins que le travail en soi de la mémoire. C’est prise dans la gangue du souvenir que chaque chose atteint sa qualité essentielle ». Le mot « foyer » revient plusieurs fois dans le poème. « Chaque moment du monde, ajoute Bouquet, s’il est considéré pour lui-même, s’il est enfoui en soi-même par la sensation-souvenir, peut devenir le foyer dont cet exilé n’a pour ainsi dire cessé de manquer. » Mais le « foyer » ainsi entendu est une notion ambivalente qui cherche à concilier l’attachement au souvenir et le désir de nouveauté, ce qui ne va pas de soi. Le poète en est bien conscient lorsqu’il s’adresse à sa compagne :
[…] Dis, Leonora, as-tu songé cette fois-là au foyer ?
[…] ô, est-ce que chaque endroit n’était pas
une vue, une pause chaque minute :
un foyer ?
est-ce que chaque séparation n’était pas douloureuse,
est-ce qu’elle n’était pas : le foyer ?
Est-ce que tout n’était pas seulement s’étreindre,
s’attacher et se séparer ?
Ne m’écoute pas. Non que j’aie quelque chose à répondre.
Affamé toujours, assoiffé, buvant des yeux, envieux
et insatiables, chaque nouvel horizon,
chaque visage, fleuve, place et pont,
m’attachant également à tout, et douloureusement
déchiré, au moment du départ.
« S’attacher et se séparer » : ainsi, le foyer serait le creuset où l’expérience présente, toujours intense, deviendrait vivant souvenir sans éteindre le désir de nouveauté.
Christian Garaud est né à Poitiers en 1937. Il est membre du comité de D’Ailleurs poésie. Après avoir enseigné le français en Irlande, en Suède et au Canada, il est devenu professeur à l’université du Massachusetts à Amherst, où il s’est tout particulièrement intéressé à Victor Segalen, Jean Paulhan, Annie Ernaux et au problème du stéréotype. Il réside maintenant à Washington. Depuis 2004, il écrit poèmes, textes et traductions dans une dizaine de revues en France et aux États-Unis. Il a publié en français entre autres aux éditions Décharge/Gros Textes, des Vanneaux, ou La Porte. Aux États-Unis, il fait aussi partie d’un groupe d’une cinquantaine de membres faisant circuler des poèmes inédits en anglais sur la toile tous les quinze jours.





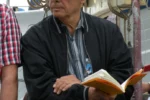
0 commentaires