Pas ailleurs, ici
Courage Son visage dans les feuilles les polygones
des pavés Elle hors de portée
Le courage de respirer La mort d’octobre
Du vin renversé La maison déconstruite La vie défaite
Graffiti sans mémoire devenus conventionnels
griffonnant le moindre mur « dieu t’aime » « la voix du ghetto »
Mort de la ville Son visage
qui dort Sa marche rapide Elle
qui court Recherche d’un espace privé La ville
qui s’effondre de l’intérieur Les leçons mal
apprises Ou pas du tout Le monde déconstruit
Cet amour unique qui coule Qui touche d’autres
vies L’amour renversé Le moindre mur qui s’effondre
Pour avoir assez de courage La vie qu’il faut vivre
dans le terrible octobre
Soudaine immersion en jaunes traces de sang La pluie rapide
Visages Inscriptions Essayer d’enseigner
des leçons impossibles à apprendre Octobre Cet amour unique
Répétitions d’autres vies Les morts
qu’il faut vivre Dénis Murs vides
Notre marche rapide côte à côte Sa fugue
L’air mauvais dans les tunnels « la voix du ghetto » « dieu t’aime »
Mon visage pâle sur la vitre la colère est pâle
le sang reflue vers le cœur
la tête tranchée inutile d’être sensible
Son visage La pluie rapide qui déchire Le courage
de ressentir ça De le raconter d’être en vie
Essayer d’apprendre des leçons impossibles à enseigner
La fugue Le sang dans mes yeux Les sutures soigneuses
déchirées Les mains qui me touchent Cela sera-t-il dit
Je ne suis pas seule
L’amour renversé cherchant son niveau inondant d’autres
vies qu’il faut vivre pas ailleurs
ici voir à travers le sang rien n’est perdu
1974

Audre Lorde, Meridel Lesueur et Adrienne Rich en 1980. Photo : K. Kendall, CC BY-2.0
Dans une postface ayant pour titre : « Qu’entendons-nous par nous ? », titre d’une conférence d’Adrienne Rich, les traductrices (Shira Abramovich et Lénaïg Cariou) citent, en même temps que la question, la réponse de trois femmes poètes : elles parlent « […] au nom de toutes les femmes dont les voix ont disparu et demeurent inaudibles ». De nombreux poèmes, dans Le Rêve d’un langage commun, mettent en lumière le sort peu connu de femmes exceptionnelles. Le dernier poème, lui, est une sorte de manifeste proposant de « changer la réalité pour nos amantes », et invitant à « renoncer au pouvoir au profit de l’amour ». Il est malheureusement trop long pour être cité en entier. Il a pour titre « Étude transcendantale », et commence par l’évocation d’une route de campagne sur laquelle roule la voiture. Des biches apparaissent :
[…] mordillant les pommes de branches précocement chargées
si alourdies, si englobées
de fruits déjà jaunissants
qu’elles semblent éternelles, hespéridéennes
dans la claire mélodie aux grillons vrombissant de l’air.
Plus tard, j’étais dans l’arrière-cour,
mes nerfs chantant l’immense
fragilité de toute cette douceur
ce monde vert déjà sentimentalisé, photographié,
publicisé à mourir. Pourtant, il persiste
obstinément […]
La réflexion continue en regardant une ferme et des champs où des génisses « méditent » :
[…] un orme mort dressant des bras décolorés
au-dessus d’un vert si dense de vie,
vie minuscule, momentanée — limaces, taupes, faisans, moucherons,
araignées, phalènes, colibris, marmottes, papillons —
le temps d’une vie est trop étroit
pour tout comprendre, à commencer par les énormes
plateaux de roche qui soutiennent toute cette vie.
Personne ne nous a jamais dit qu’il nous fallait étudier nos vies,
faire de nos vies une étude, comme si nous apprenions l’histoire naturelle […]
On passe brusquement de l’évocation d’animaux vivant en liberté dans leur cadre naturel à celle des femmes victimes d’une société qui les a empêchées de connaître leur vraie nature :
[…] Tout au plus on nous laisse quelques mois
à simplement écouter la ligne simple
de la voix d’une femme qui chante un enfant
contre son cœur. Tout le reste est trop tôt,
trop soudain, le déchirement, le battement du cœur de cette femme
entendu depuis à distance,
la perte de cette note fondamentale qui résonne
quand nous sommes heureuses, ou au désespoir […]
Résultat : « rien de ce qui a été dit / n’est vrai pour nous ». L’essentiel est « un attachement au timbre, / aux tons ce que nous sommes, (attachement) à demi-aveugle, obstiné / — même quand tous les textes le décrivent différemment ». La métaphore musicale se poursuit : une femme « répète dans son corps, écoute dans son sang / une partition déclenchée en elle peut-être / par des mots, quelques accords, depuis la scène : / un conte qu’elle seule peut raconter ».
Pour que change la situation et que puisse exister une nouvelle poésie, la tâche est ardue :
[…] Aucune de celles qui ont survécu pour parler
un langage nouveau, n’a évité ça :
l’arrachement d’une force ancienne qui la maintenait
enracinée dans un sol ancien
le ton d’une solitude totale
où elle-même et toute la création
semblent également dispersées, en apesanteur, son être un cri
dont aucun écho ne revient ou ne pourra jamais revenir […]
C’est l’aventure dans laquelle se sont lancées Adrienne Rich et Michelle Cliff (à laquelle le poème est dédié) :
deux femmes, les yeux dans les yeux
mesurant l’esprit l’une de l’autre, de l’une et l’autre
le désir illimité,
une toute nouvelle poésie commence ici.
Le poème se termine par l’évocation d’une femme, cette fois libérée :
[…] rassemblant les principes d’une vie
sans la moindre volonté de maîtrise,
seulement l’attention aux formes inachevées
aux vies multiples, dans lesquelles elle se retrouve elle-même,
devenant tantôt l’éclat de verre brisé
découpant la lumière dans un coin, dangereux
pour la chair, tantôt la feuille abondante, douce
qui, enroulée autour du doigt lancinant, apaise la blessure ;
et tantôt la pierre de fondation, le plateau de roche qui continue
de se former en dessous de tout ce qui pousse.
1977
Ces « vies multiples, dans lesquelles elle se retrouve elle-même », ce « plateau de roche qui continue / de se former en dessous de tout ce qui pousse » font écho au début du poème et servent de point d’orgue.
À la fin de leur postface, les traductrices écrivent ceci : « nous avons construit une langue qui nous semblait transmettre au mieux l’entreprise d’Adrienne Rich dans ce recueil, tout en nous autorisant, comme l’écrit Noémie Grunenwald dans son essai sur la traduction féministe, à nous en faire “une alliée précieuse pour se comprendre, une camarade pour lutter, une complice pour traduire ce ‘nous’ qui construit notre libération” ». Il serait intéressant de comparer cette traduction avec une autre qui ne se revendiquerait pas féministe. Y aurait-il une si grande différence ?
Christian Garaud est né à Poitiers en 1937. Il est membre du comité de D’Ailleurs poésie. Après avoir enseigné le français en Irlande, en Suède et au Canada, il est devenu professeur à l’université du Massachusetts à Amherst, où il s’est tout particulièrement intéressé à Victor Segalen, Jean Paulhan, Annie Ernaux et au problème du stéréotype. Il réside maintenant à Washington. Depuis 2004, il écrit poèmes, textes et traductions dans une dizaine de revues en France et aux États-Unis. Il a publié en français entre autres aux éditions Décharge/Gros Textes, des Vanneaux, ou La Porte. Aux États-Unis, il fait aussi partie d’un groupe d’une cinquantaine de membres faisant circuler des poèmes inédits en anglais sur la toile tous les quinze jours.




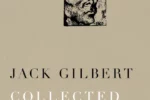

0 commentaires