Comment chroniquer ce volume de quelque 650 pages, deuxième tome des œuvres complètes d’un poète reconnu dans le monde francophone et au-delà (par ses traductions de la poésie sud-américaine, entre autres) ? Sans faire de recension, tout simplement. En picorant des vers au fil des pages, avec l’espoir qu’ils touchent, motivent et incitent à aller plus loin. En tout cas, il importait de saluer l’entreprise de réédition des recueils du Luxembourgeois par La Rumeur libre, par-delà les modes ou les chapelles éphémères (voire durables) — c’est d’ailleurs là le programme de la collection sobrement nommée « La Bibliothèque ».
S’enfoncer dans la poésie de Jean, c’est d’abord se coltiner avec la langue en sa compagnie ; quel autre volume que L’Étrange Langue, prix Mallarmé en 2003, pour commencer ? Le « collier du nord » au cou, le poète, ballotté entre l’Italie des origines et le grand-duché qui accueille sa famille, nous prévient : « là commence une autre langue. / elle me la donne et je la verse dans le café. » Déracinement comme prélude aux strophes, vocables culinaires, famille omniprésente aussi : c’est une poésie de l’exil et de l’asile qui se déploie, une poésie qui retrouve des accents d’enfance et qui triture les symboles, en malaxe la pâte croustillante après cuisson. Car « le sud de mon cerveau est un cyprès / comme ceux de l’allée du cimetière », et les points cardinaux s’opposent autant qu’ils fusionnent. Étrange, la langue ? Peut-être au premier abord. Mais addictive si l’on s’y perd volontairement.
Suit Le Travail du poumon. On connaît la métaphore souvent utilisée par l’auteur, qui écrit que l’italien, langue maternelle, respire sous sa langue d’écriture, le français, devenant une « langue baleine » : ce mammifère pourtant marin a des poumons, et c’est cette image que développe Jean dans la dernière partie du recueil. Ses dix-neuf fragments en prose composent ainsi une poétique de son œuvre — ou plutôt une des poétiques, car son discours théorique s’est transformé, a évolué par la suite. Auparavant, il explore cependant en plusieurs parties quelques-uns de ses thèmes fétiches ; le Nord et le Sud sont bien entendu au programme, mais il étend sa poésie très ancrée dans la famille aux amitiés littéraires (Borges ou Gelman, par exemple) sous la forme d’hommages. La nature, chez lui, stimule d’abord l’esprit : « walt whitman a dit levain du sol et j’ai pensé au ferment de la vengeance qu’animent certains retours ».
Une des quatre parties d’En réalité est consacrée à une autre figure récurrente des œuvres du poète : « respire-t-elle encore / la bête dépecée / l’odeur qui la protège // descend comme d’un couteau / plus bleu qu’un gyrophare ». Il s’agit là d’un épisode où, roulant de nuit pour se rendre au Luxembourg au chevet de son père mourant, l’auteur voit un cerf se précipiter sur la route et, percuté par la voiture, planter ses bois dans le pare-brise. Point n’est besoin de comprendre le réel derrière les vers, cependant, pour accrocher au texte : la langue, dans les poèmes, tisse un cocon de bien-être qui invite à s’y glisser pour une ou plusieurs pages, voire à goulûment parcourir un recueil entier. Sous-titré « Le travail de l’étrange langue », l’épais volume qui fait l’objet de cet article annonçait d’ailleurs la couleur dès la couverture… et tient ses promesses.
Dans La Réinvention de l’oubli, le travail de mémoire se voit exprimé, orné au moyen de l’étrange langue : « le fer a été son somnifère », peut-on par exemple lire à propos du père de Jean Portante, à l’évocation de la vie de mineur dans un Luxembourg dépendant des travailleurs immigrés. La nostalgie, le mal du pays (mais lequel ? c’est aussi un questionnement récurrent) sont là, creusent les mots : « la langue de mon père s’est refroidie / comme un alignement de statues de scories », comme si la grande et la petite histoire laissaient bouche bée dans leur union. Chez Jean, ce ne sont pas les têtes couronnées ni les vainqueurs qui sont nos guides à l’évocation des siècles passés. Sa poésie est à hauteur des êtres simples mais pas simplistes, des êtres sains dans une vie authentique, pas une vie rêvée. La langue a beau se parer de figures de style, sous elle transpire l’authenticité.
Enfin, c’est le recueil Conceptions qui clôt ce deuxième tome des œuvres poétiques. Il s’agit d’un hommage à la mère de l’auteur, lequel, à son chevet, compose des poèmes pour accompagner son départ : « il y a un forgeron de sommeil / Sous l’économie de tes paupières. » Conçu par sa génitrice, le poète boucle la boucle de l’existence de celle-ci en concevant, dans sa langue à lui, un portrait en creux sous forme de livre entier, qui vient compléter une poésie familiale, de l’amitié littéraire, mémorielle et à l’écoute des pulsations lyriques cachées sous la carapace du monde réel. C’est cette constance des sujets, ces obsessions répétées dans un écrin de mots où se cachent d’autres mots qui rendent les vers de Jean Portante précieux.
Jean Portante, Œuvres poétiques, tome II, La Rumeur libre éditions, ISBN 978-2-35577-319-8
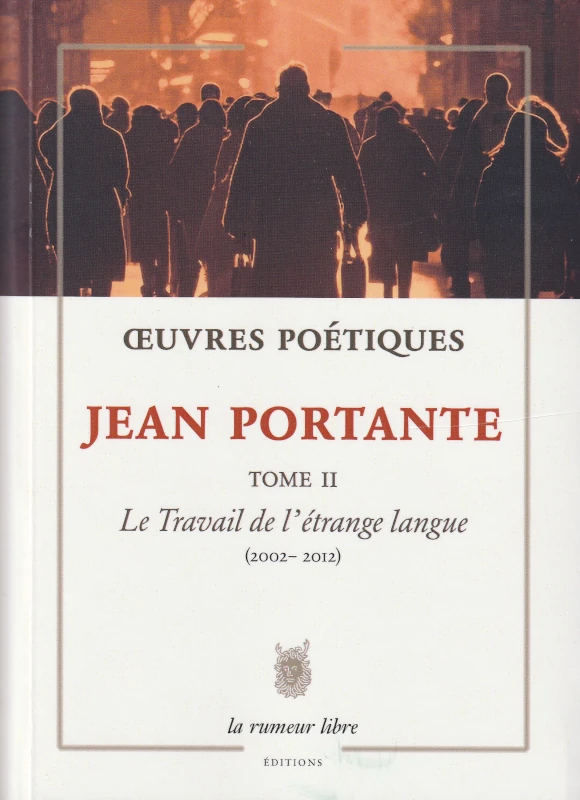
Mon buveur de mémoire
Florent Toniello, né en 1972 à Lyon, est le responsable de ce site, membre du comité de D’Ailleurs poésie. Il commence une première vie dans l’informatique au sein d’une société transnationale, à Bruxelles et ailleurs. En 2012, il s’installe dans la capitale grand-ducale ; sa deuxième vie l’y fait correcteur, journaliste culturel et poète. S’ensuivent neuf recueils de poésie publiés au Luxembourg, en Belgique et en France, une pièce de théâtre jouée au Théâtre ouvert Luxembourg, ainsi qu’un roman et un recueil de nouvelles de science-fiction. Pour l’instant, il n’est pas question d’une troisième vie. Son site : accrocstich.es.






0 commentaires