Ne craignez rien
Le monde
Ne manquera jamais
De poèmes
La réalité manquera
Peut-être de réalité
L’amour manquera
D’amour
La mort sans doute
De mort
L’émotion manque
Aux machines
Qui sait s’il manque
Déjà
De l’âme aux âmes
Mais ne doutez pas
Le monde
Ne manquera jamais
De poésie
Voilà qui est encourageant. Ce site, de façon très modeste et parmi tant d’autres, ne veille-t-il pas à ce qu’on ne manque pas de poésie ? Voici aujourd’hui Tomas Tranströmer (1931-2015), poète suédois que je découvre — avec quel retard ! Il a reçu le prix Nobel de littérature en 2011. Psychologue de profession, il a commencé à écrire et à publier des poèmes au milieu des années 1950. Bien que son œuvre ait été relativement peu connue en France avant la fin du XXe siècle, elle a très tôt été traduite en Europe et aux États-Unis, et sa réputation n’a cessé de grandir. J’ai entre les mains, préparée avec l’accord de l’auteur, l’anthologie qui a été publiée en France et au Québec par Le Castor astral et Les Écrits des forges en 1989. La traduction est celle de Jacques Outin. L’anthologie a pour titre Baltiques et autres poèmes. « Baltiques » (1974) est un long poème autobiographique avec le texte suédois et le texte français en regard. Les autres livres de poèmes représentés sont Accords et Traces (1966), Visions nocturnes (1970), Sentiers (1973), La Barrière de vérité (1978), La Place sauvage (1983) et Pour les vivants et pour les morts (1989). Je choisis le long poème « Carillon » (où est mentionnée cette « place sauvage » qui sert de titre au recueil de 1983). Mon émotion et mon admiration augmentent au fur et à mesure que je le transcris pour vous, lecteurs :

Photo : Andrei Romanenko, CC BY-SA 3.0
Carillon
Madame méprise ses clients parce qu’ils veulent loger dans son hôtel crasseux.
J’ai la chambre du coin au deuxième étage : un mauvais lit, une ampoule au plafond.
Et chose curieuse de lourdes draperies où parade un quart de million de mites invisibles.
Dehors une rue piétonnière
avec des touristes flâneurs, des écoliers pressés, des hommes en bleu de travail qui poussent des vélos cliquetants.
Ceux qui croient qu’ils font tourner le monde et ceux qui croient qu’ils tournent, impuissants, sous l’emprise du monde.
Une rue que nous prenons tous, mais où mène-t-elle donc ?
La seule fenêtre de la chambre s’ouvre sur une autre chose : La Place Sauvage,
un terrain en ébullition, une immense surface frissonnante, parfois noire de monde, et parfois désertée.
Ce que je porte en moi se matérialise ici, toute mon angoisse, tous mes espoirs.
Toutes ces choses impensables qui arriveront pourtant.
Mes rivages sont bas, si la mort montait de vingt centimètres, je serais submergé.
Je suis Maximilien. En l’an 1488. On me tient enfermé ici à Bruges
parce que mes ennemis sont indécis —
ce sont de méchants idéalistes, et je ne peux décrire ce qu’ils ont fait dans l’arrière-cour de l’horreur, ne peux changer le sang en encre.
Je suis aussi cet homme en bleu de chauffe qui tire son vélo cliquetant, là en bas, dans la rue.
Je suis aussi celui qu’on voit, le touriste qui marche et puis s’arrête
et qui laisse errer le regard sur les visages blafards brûlés par la lune et les tentures houleuses des vieilles peintures.
Personne ne décide où je vais, et encore moins moi-même, mais chaque pas se fait où il faut.
Pouvoir se promener dans des guerres fossiles où tous sont invulnérables parce que déjà morts !
Les masses de feuilles poussiéreuses, les remparts avec leurs meurtrières, les allées des jardins où des larmes pétrifiées craquent sous les talons…
Aussi inattendues que si j’avais trébuché sur un fil en acier, les cloches se sont mises à sonner dans la tour anonyme.
Carillon ! Le sac éclate aux coutures et les accords roulent sur la Flandre.
Carillon ! Fonte roucoulante des cloches, psaume et rengaine, tout en un, qui s’inscrit en tremblant dans les airs.
Le docteur aux mains tremblantes rédige une ordonnance que personne ne peut déchiffrer, on reconnaît pourtant l’écriture…
Sur les toits et les places, sur l’herbe et le blé,
aux morts et aux vivants les cloches ont sonné.
Infimes différences du Christ à l’Antéchrist !
Les cloches finalement nous ramènent sur la piste.
Elles se sont tues.
Je suis revenu dans ma chambre d’hôtel : le lit, la lampe, les draperies. On entend des bruits curieux d’ici, la cave lentement remonte l’escalier.
Je suis couché sur mon lit les bras en croix.
Je suis une ancre confortablement enfouie qui retient l’ombre profonde au-dessus d’elle,
cette grande inconnue dont je participe et qui est certainement plus importante que moi.
Dehors passe la rue piétonnière, cette rue où mes pas se meurent, comme ce que j’écris, ma préface au silence, mon psaume retroussé.
C’est pour moi comme un morceau de musique où alternent et se mêlent des thèmes et des tons bien différents. L’ironie du début à l’égard de « Madame » est amusante et sans méchanceté : le voyageur ne s’indigne pas vraiment de l’inconfort et de la saleté de sa chambre. Puis on passe à l’évocation de la rue piétonnière où circulent toutes sortes d’individus, mais c’est tout de suite pour les diviser en deux catégories qui élargissent la perspective, et le dernier vers de la strophe l’élargit encore : nous voici inclus parmi ceux qui déambulent, et cette rue, « où mène-t-elle donc ? ». Elle est caractéristique du poète, cette façon de passer brusquement de détails concrets de sa vie quotidienne à des questions d’ordre philosophique qui nous concernent tous.
Les trois strophes suivantes procèdent de la même façon, mais le ton s’assombrit. La seule fenêtre de la chambre donne sur « La Place Sauvage ». Je n’ai pas trouvé de place portant ce nom à Bruges. En revanche, c’est le titre du recueil où figure le poème, et nous verrons à quoi ce nom de « place sauvage » fait allusion. On sait seulement que c’est un lieu que le poète associe à son état d’esprit fait d’angoisses et d’espoirs. Comment ne pas penser qu’il y a plus d’angoisses que d’espoirs lorsqu’on lit ce vers extraordinaire : « Mes rivages sont bas, si la mort montait de vingt centimètres, je serais submergé. » Un critique a fait remarquer que, dans sa jeunesse, le poète a été influencé par la lecture d’André Breton. Je me rappelle un collage de Breton : une femme descend un escalier, une voix demande : « Tu t’en vas ? », et la femme répond : « La terre fait eau de toutes parts. »
Ce je désemparé, le voici soudain transporté au XVe siècle. Il est l’archiduc Maximilien d’Autriche, fait brièvement prisonnier par les habitants de Bruges parce qu’ils voient leurs privilèges menacés. Maximilien se rappelle la cruauté de ces révoltés « idéalistes » qui ont décapité sur la place, il y a peu, son conseiller Pieter Lanchals. Mais le poète est aussi cet « homme en bleu de chauffe » et aussi ce touriste visitant les musées où il va voir « les vieilles peintures ». Dans un autre poème, il écrit : « J’étais en un lieu qui rassemblait tous les instants — un musée de lépidoptères » (Les secrets en chemin, 1958). Un je libre de circuler dans le temps ? Tout de suite resurgit l’ironie à l’égard de lui-même : facile pour un touriste de se promener parmi les « guerres fossiles » ! Mais l’ironie disparaît avec ces « larmes pétrifiées qui craquent sous les talons ». Quelle image !
La méditation est brutalement interrompue par une explosion : celle du carillon qui donne son titre au poème. Quel est ce docteur dont personne ne peut déchiffrer l’ordonnance ? Le Christ et l’Antéchrist semblent renvoyés dos à dos. À quoi ces cloches ont-elles servi « aux vivants et aux morts » ? La question reste sans réponse. Lorsque les cloches se taisent, retour à la chambre d’hôtel où « la cave remonte l’escalier » : encore une image surréaliste ! Le poète, dans son lit, est « couché les bras en croix » ? Retour au carillon de la tour ? Non. « Je suis une ancre confortablement enfouie qui retient l’ombre profonde au-dessus d’elle, cette grande inconnue dont je participe et qui est certainement plus importante que moi. » Avec une touche d’humour (« confortablement »), voici que le poème évoque, avec une image magnifique, l’énigme de notre existence et l’insignifiance du moi.
Ah ! J’ai trop joué au professeur ! Pardonnez-moi. Un dernier vers de lui (cueilli ailleurs) à se dire en ouvrant les yeux : « L’éveil est un saut en parachute hors du rêve » (Prélude, 1954). Quelle meilleure façon de commencer la journée ?
1 Commentaire
Soumettre un commentaire
Christian Garaud est né à Poitiers en 1937. Il est membre du comité de D’Ailleurs poésie. Après avoir enseigné le français en Irlande, en Suède et au Canada, il est devenu professeur à l’université du Massachusetts à Amherst, où il s’est tout particulièrement intéressé à Victor Segalen, Jean Paulhan, Annie Ernaux et au problème du stéréotype. Il réside maintenant à Washington. Depuis 2004, il écrit poèmes, textes et traductions dans une dizaine de revues en France et aux États-Unis. Il a publié en français entre autres aux éditions Décharge/Gros Textes, des Vanneaux, ou La Porte. Aux États-Unis, il fait aussi partie d’un groupe d’une cinquantaine de membres faisant circuler des poèmes inédits en anglais sur la toile tous les quinze jours.

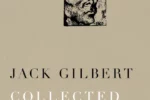




un poète si moderne, libre d’influences, simple et mystérieux.
un grand prix Nobel